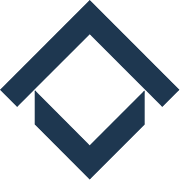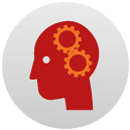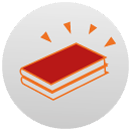Qualité pour agir en procédure civile de l’administrateur (art. 712t CC) – Pour mener une procédure civile au nom de la communauté des copropriétaires, l’administrateur doit, en dehors de la procédure sommaire, être préalablement autorisé par l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence dans lesquels l’autorisation peut être obtenue ultérieurement. L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée des copropriétaires. Si l’administrateur ne prouve pas l’existence d’une autorisation préalable ou s’il a agi dans l’urgence, le tribunal lui impartit un délai pour apporter la preuve de sa qualité pour agir. Si l’assemblée des copropriétaires l’autorise dans le délai supplémentaire imparti, elle approuve les actes de procédure initialement accomplis sans procuration et remédie au vice avec effet ex tunc. L’autorisation est une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office (consid. 4.1.2).
Répartition des frais et charges communs (art. 712h CC) – Rappel des principes. L’art. 712h al. 3 CC est une disposition de protection qui s’applique lorsque la répartition proportionnelle à la valeur des quotes-parts de certains frais ou charges communs semble inéquitable. Elle est de nature impérative (consid. 5.1.1). L’ancrage dans le règlement de la répartition des frais et charges communs selon la valeur des quotes-parts n’oblige pas la communauté des propriétaires d’étages à modifier le règlement pour s’écarter de cette clé de répartition (consid. 5.1.2.2). Cela peut se faire par une simple décision de l’assemblée des copropriétaires. La majorité simple est suffisante lorsque le règlement est muet sur la répartition, alors que la majorité nécessaire à la modification du règlement est exigée si la répartition décidée déroge à celle prévue par le règlement (consid. 5.1.2.3).
En l’espèce, l’assemblée des copropriétaires d’une PPE sur plan partiellement bâtie a exonéré les propriétaires des parts d’étages non construites des frais et charges communs. Pour le TF, cela ne saurait constituer une inégalité de traitement (consid. 5.1.3.2).
PPE sur plan (art. 69 ORF) – Rappel des principes (consid. 5.1.3.4). Le propriétaire d’une unité d’étage non (encore) construite dispose lui aussi du droit intangible et inaliénable de participer à l’assemblée des propriétaires d’étages et de prendre part aux décisions de celle-ci (consid. 5.1.3.5). En l’espèce, il faut partir du principe que l’ensemble du bâtiment – donc également les parties communes – est objectivement et définitivement inutilisable pour les propriétaires des unités non réalisées. Il existe donc une raison objective à l’exonération des frais (consid. 5.1.3.6). S’agissant de la dérogation à la répartition proportionnelle aux quotes-parts, la seule constellation préoccupante est celle où (exclusivement) les propriétaires par étages privilégiés détiennent simultanément une position de force dont ils pourraient abuser au détriment des autres propriétaires, ce qui n’est pas réalisé en l’espèce (consid. 5.1.3.8).
Action en annulation des décisions de l’assemblée – L’action en annulation est en principe de nature cassatoire. Cela signifie qu’aucune obligation ou action ne peut être imposée à la communauté des propriétaires d’étages dans le cadre du jugement. Une action en annulation visant l’annulation partielle de la décision est en principe recevable, mais présuppose, selon la doctrine, que la décision soit matériellement divisible (consid. 5.3.1.1).
Travaux de construction sur les parties communes – La réalisation de tels travaux exige qu’une décision (dite décision de dépenses) ait été prise non seulement sur l’exécution des mesures concernées en tant que telles, mais aussi sur les frais qu’elles occasionnent (consid. 5.3.2.4). Si la loi permet à l’assemblée des propriétaires d'étages de décider de la création d’un fonds de rénovation pour des travaux d’entretien et de rénovation (art. 712m al. 1 ch. 5 CC), il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas décider d’un apport pour des mesures d’assainissement qui restent à concrétiser ; le grief selon lequel il n’est pas possible de forcer un propriétaire d’étages à verser sa contribution pour des travaux encore indéterminés est donc rejeté, dans la mesure où la nécessité d’assainir n’est pas contestée en l’espèce (consid. 5.3.3.3).
Délai de convocation de l’assemblée générale – Un délai de convocation ne respectant pas celui prévu par le règlement ne rend pas automatiquement nulles les décisions prises pendant l’assemblée, en particulier lorsque le propriétaire d’étages qui s’en prévaut a participé à l’assemblée et qu’il n’explique pas en quoi cette irrégularité lui aurait causé un préjudice. L’annulation ne peut aboutir que si la violation du règlement a eu ou aurait pu avoir un effet causal sur la formation des décisions (consid. 5.4.1.6).
Procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires – Il faut contester les décisions elles-mêmes consignées dans le procès-verbal approuvé, ce qui a été fait en l’espèce. Contester en plus l’approbation du procès-verbal n’est ni nécessaire, ni pertinent, s’il s’agit de remettre en cause le contenu matériel des décisions. C’est uniquement si la consignation des décisions au procès-verbal n’a pas été faite correctement qu’il se justifie d’en exiger la rectification (consid. 5.4.2.3).
Prescription des contributions – En l’occurrence, le TF laisse ouvert la question de savoir quel délai de prescription est applicable aux contributions des propriétaires d’étages (5 ou 10 ans selon 128 ch. 1 ou 127 CO). Si la prescription est interrompue par une action en justice, elle recommence à courir lorsque le litige est clos, à savoir lorsque les voies de recours sont épuisées. En l’espèce, le délai a été interrompu avant que la prescription ne soit acquise et n’a donc pas encore recommencé à courir (consid. 6.3.3.2).
Exception d’inexécution (art. 82 CO) – Un propriétaire d’étages ne peut pas se prévaloir de l’art. 82 CO en relation avec des créances de cotisations impayées, faute d’un rapport d’échange (consid. 6.3.4.2).
Hypothèque légale de la communauté des propriétaires d’étages (art. 712i CC) – Rappel des principes (consid. 6.1). L’hypothèque vise à garantir les contributions des trois dernières années dues par les propriétaires d’étages. Après une interprétation principalement téléologique de la loi (consid. 6.1.2.10), le TF retient que le délai de trois ans prévu par la loi doit être calculé rétroactivement à partir du dépôt de la requête d’inscription du droit de gage communautaire. Pour une créance de cotisations arrivée à échéance le 30 septembre 2020, alors que l’exercice comptable s’étendait du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la demande d’inscription du droit de gage communautaire devrait être déposée au plus tard le 30 septembre 2023, c’est-à-dire trois ans après l’échéance de la créance de cotisations.